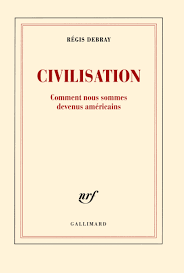Route du Tour, envoyé spécial.
Illustration de cette quête errante de l’esprit aventurier, aimanté toujours par l’attrait même de son insoumission en tant que genre, le Tour se jette cette fois dans une sacrée inconnue. Celle-ci porte un nom, le plus célèbre du peloton actuel: Chris Froome. Et s’il convient de s’intéresser d’entrée de jeu au Britannique, alors que la 104e édition s’élancera samedi depuis Düsseldorf, en Allemagne, il suffit de suivre la logique du chronicœur pour en comprendre les raisons. Leader incontesté d’une équipe Sky (au centre de très nombreux soupçons de dopage depuis l’automne et l’hiver derniers), mais en difficulté physique et psychologique depuis le début de saison, en particulier lors du Dauphiné où il semblait avoir la tête ailleurs, le triple vainqueur de la Grande Boucle affiche un inédit «zéro» au nombre de ses victoires en 2017. De quoi surprendre. Et fantasmer un peu.
Car de lui dépend l’essentiel des scénarios qui s’écriront d’ici trois semaines. Personne n’en doute, au point que ses adversaires eux-mêmes, sauf peut-être son «pote» et ex-équipier Richie Porte (BMC), se conforment déjà à la bonne volonté – ou non – du maître. «Si Froome est à son niveau habituel, qui peut croire qu’il ne gagnera pas son quatrième?», commente, lucide, Alberto Contador. Le tenant du titre préfère tempérer: «La concurrence est encore plus forte que lors des dernières années. Richie (Porte) est le favori, au regard de ce qui s’est passé dans le Dauphiné. Il était le plus fort en montagne et contre la montre. Il est l’homme à battre.» Mais Froome rajoute aussitôt: «Moi, je suis très en forme, je sens que je suis prêt. Je me suis reposé après le Dauphiné et je suis plus frais que je ne l’ai jamais été.» Nairo Quintana et Thibaut Pinot, tous deux sortis rincés et vaincus du Giro, sont prévenus. Sans parler de Romain Bardet, deuxième l’an dernier, qui lorgne avec envie sur le profil très montagneux de ce Tour. La vérité se résume en deux hypothèses: soit Froome «y est», et l’affaire paraît mal engagée pour les autres; soit il n’«y est pas», et nous aurons devant nous une jolie page vierge. Juste un indice: il y a un mois, la rumeur courait que Froome rejoindrait BMC en 2018. «Nous sommes dans un processus de prolongation avec Sky jusqu’en 2021», a tranché le Britannique, ce mercredi, en arrivant à Düsseldorf. L’esprit aventurier existe-t-il encore?
[ARTICLE publié dans l’Humanité du 30 juin 2017.]